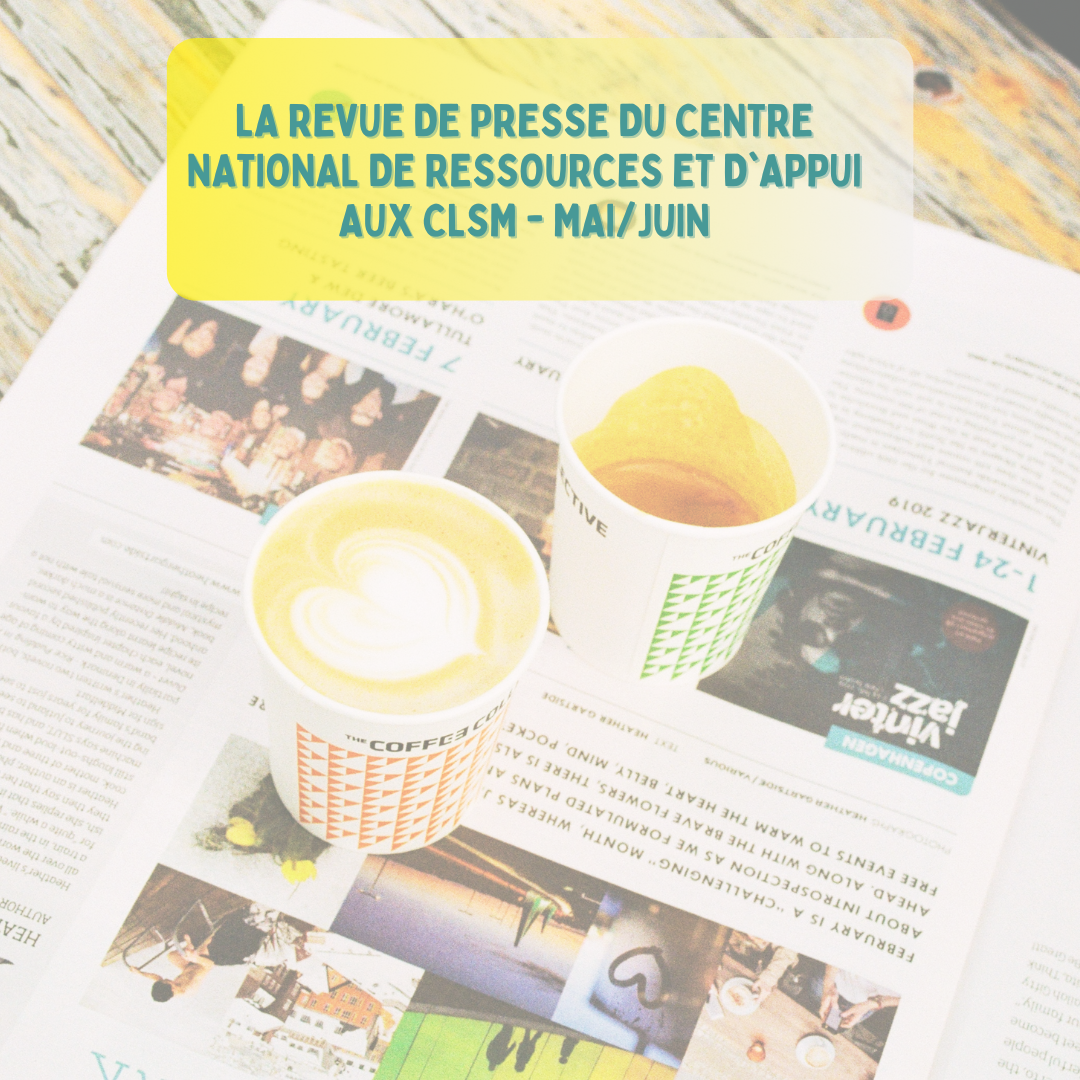La revue de presse du Centre national de ressources et d’appui aux CLSM (mai/juin)
Le Centre, dans ce format, vous propose de revenir sur l’actualité de mai et juin à travers la presse quotidienne régionale : créations de nouveaux CLSM, initiatives locales en santé mentale communautaire… Retrouvez toutes les infos à ne pas manquer !
Les CLSM vus par la presse locale et régionale
Ouest-France revient sur l’élargissement du conseil local de santé mentale de Caen, créé dès 2016 et dont le coordinateur actuel est Gérald Halley.
Après avoir développé les objectifs d’un CLSM, Ouest-France laisse ce dernier détailler les actions du CLSM : « Nous avons mené des actions de sensibilisation auprès de la population, notamment sur les marchés au Calvaire-Saint-Pierre ou Saint-Sauveur. Nous organisons des événements comme la Semaine de la santé mentale, des ciné-débats, des conférences. Ainsi que des actions de formation. ».
Enfin, le journal évoque la signature, par les mairies voisines d’Hérouville-Saint-Clair et de Mondeville, d’une convention avec la ville de Caen pour intégrer le CLSM. Celles-ci, en effet, sont de plus en plus confrontées à des problématiques de santé mentale nécessitant une prise en charge urgente – d’où, pour elles, l’utilité de l’interface partenariale qu’est le CLSM, qui permet d’associer des acteurs très divers à toutes les étapes des parcours de soin.
Le Progrès, dans l’édition d’Oyonnax, revient sur la création d’un pôle santé pluridisciplinaire à Valserhône (Ain), avec en parallèle la signature, avec l’ARS, d’un contrat local de santé de cinq ans, comprenant la création d’un CLSM. L’objectif est de réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé, en favorisant une offre de proximité, dans un territoire touché de plein fouet par la désertification médicale : la Communauté de communes du pays bellegardien (CCPB), dont le siège est Valserhône, a été classée par l’ARS en zone d’intervention prioritaire concernant l’accès aux soins.
Si le CLS comprend la création d’un CLSM, c’est parce que le diagnostic local de santé a fait ressortir la santé mentale comme la seconde priorité du territoire après l’accès à l’offre de soin. D’ailleurs, le futur pôle de santé se situera à proximité de la clinique psychiatrique et psychosomatique ; le futur CLSM aura donc d’autant plus de latitude pour créer le décloisonnement à même de favoriser l’accès aux soins, au même titre qu’un renforcement simultané de l’offre de soins.
S’inspirer : des initiatives locales en santé mentale communautaire
Des initiatives pour lutter contre les addictions
Le Courrier Picard, dans son édition de la Haute-Somme, aborde l’action de l’association Addictions France dans la Somme, où elle compte cinq antennes – à Péronne, Roye, Abbeville, Amiens et Friville – et 26 salariés.
À Péronne, par exemple, 400 patients se rendent sur les lieux chaque semaine, pour des addictions diverses : tabac et alcool bien sûr, mais aussi cannabis, médicaments, jeux d’argent, à gratter ou de paris, ou encore jeux vidéo. La dépendance, « moment où on perd la liberté de s’abstenir » selon Mélanie Bidard, la directrice de l’association, peut être psychique et/ou physique. De fait, il suffit au patient de prendre rendez-vous et de venir sur place ; les soins sont gratuits, et il est possible d’en bénéficier de manière anonyme (en utilisant un pseudo). Les consultations peuvent également être organisées par les proches d’une personne dépendante, ou par la justice dans le cadre d’une obligation de soins. Néanmoins, l’approche d’Addictions France n’est pas d’imposer d’emblée un arrêt de la consommation, mais d’amener une réduction de celle-ci après une prise de conscience créant les conditions propices au soin.
Certaines initiatives illustrent, par ailleurs, l’intérêt du medium culturel pour aborder la question des addictions. À ce sujet, Sud-Ouest, à Mont-de-Marsan, se fait l’écho d’un ciné-débat organisé par une autre association, Cap Addictions. Le film projeté, « Tout pour être heureux ? Un voyage inédit au cœur des familles » raconte l’histoire de Jérôme Adam, qui a perdu son frère à cause des drogues. En prenant l’angle des « aidants » plutôt que celui des consommateurs eux-mêmes, la projection a nourri un riche temps d’échange sur la parentalité et les relations familiales, dans une atmosphère de libération de la parole.
Sur le même sujet, Le Progrès, à Rive-de-Gier (Loire), revient sur la projection dans un cinéma d’un clip de prévention des risques liés aux addictions, réalisé par des jeunes et pour des jeunes. Ce clip est l’aboutissement d’un projet initié par Addictions France, qui avait répondu à un appel à projet financé par la CPAM et l’ARS afin de créer ce type d’outil. Intitulé My Beautiful Boy, il intègre des témoignages de jeunes consommateurs, un slam, créé pour retranscrire leurs paroles, ou encore des échanges avec des personnes âgées d’un Centre social sur les addictions et le slam du projet. Cet outil de prévention « va désormais servir de support pour des interventions, pour échanger avec d’autres publics » dit Jordan Foureouse, chargé de mission chez Addictions France.
À Janzé (Ille-et-Vilaine), Ouest-France détaille justement un atelier de prévention organisé auprès des jeunes d’une Maison familiale rurale (MFR) par l’association Unis-Cité de Rennes. Né du constat, par des professeurs de la structure, de l’importance du sujet de la santé mentale chez les élèves, ce temps d’échange permet notamment de libérer la parole sur les addictions (tabac, alcool, etc.) ou de discuter de l’importance du sommeil et de la « santé morale ». Il s’agit d’outiller ces jeunes face à des problèmes particulièrement aigus à leur âge, et de leur donner une culture commune.
Enfin, Ouest-France décrit un lieu ouvert à Lyon depuis un an, et qui est depuis lors unique en France : un centre ressource des addictions médicamenteuses, qui a déjà accueilli 75 patients. Ces dernières, souvent sous-estimées, sont d’autant moins repérées qu’elles concernent des produits prescrits légalement, mais qui font progressivement l’objet d’un mésusage, à l’instar du Tramadol, puissant opioïde. Ces addictions, qui ont un effet délétère au long cours, rencontrent peu souvent une offre de soin adaptée pour les traiter, y compris dans les CHU – d’où l’intérêt du Centre ressource lyonnais des addictions médicamenteuses (Cerlam). Ce dernier adopte ainsi une approche transversale, où le travail se mène sur le champ du sevrage mais aussi dans l’analyse de la cause profonde de l’addiction, du besoin réel qui a poussé à prendre le médicament dans un premier temps. Surtout, le Cerlam a pour objectif de faire de la prévention, en particulier auprès des médecins généralistes qui adressent au Centre la majorité de ses patients ; cela permet de libérer la parole entre professionnels de santé sur l’addictologie. Le Centre, en tout cas, espère créer des émules, et s’insérer encore davantage dans la cité.
Tous ces articles, bien que présentant des initiatives diverses, illustrent les dénominateurs communs d’une approche efficace des addictions – réduction des risques et prévention plutôt que répression ; libération de la parole plutôt que cadrage vertical du débat ; non-jugement et écoute plutôt que stigmatisation.